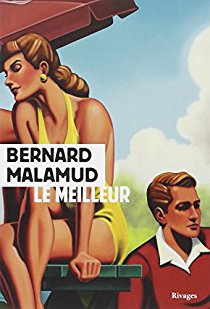Le Meilleur : roman vs ciné, la Battle !
J’ai enfin lu l’un des romans cultes du baseball, et de la littérature américaine, le Meilleur (The Natural en VO). Écrit par le grand romancier américain Bernard Malamud (Prix Pulitzer 1967, National Book Award 1959 & 1967), publié en 1952, "Le Meilleur" a été traduit et publié en français très récemment (2015) par les éditions Rivages.
En France, quand on cite Le Meilleur, le fan de baseball vous répondra Robert Redford. Car en 1984, Barry Levinson adapta ce roman en un film devenu culte au sein des passionné.es de la petite balle blanche aux coutures rouges. L’immense Robert Redford y interprète donc Roy Hobbs, joueur de baseball au talent incomparable.
Spoiler alert ! Si vous continuez la lecture, vous prenez le risque d’en savoir trop sur le roman comme sur le film. Je vous conseille donc, si vous souhaitez lire le roman ou découvrir le film, de mettre en pause la lecture de cet article et de vous précipiter sur l’œuvre en version papier et cinématographique.
Le pitch : Roy Hobbs est un jeune gars de la campagne et un joueur de baseball incroyablement doué. Alors qu’il se rend à Chicago pour un essai chez les Cubs, il rencontre une femme fatale. Pas seulement au sens érotique du terme mais aussi au sens mortel puisqu’elle va lui tirer dessus, se révélant être une serial killer pour champions sportifs. La carrière du phénomène s’arrête brutalement. Plus de 15 ans après, le voilà de retour, au milieu de la trentaine, pour tenter une nouvelle fois sa chance et imposer au monde du baseball sa vérité : il est le meilleur joueur de baseball de l’Histoire.
Roman et film partagent un début de fiction assez similaire mais avec quelques différences notables qui vont s’amplifier tout le long de leur progression narrative jusqu’à une fin diamétralement opposée. Pour aller vite, Le Meilleur version roman est ombre là où le film est lumière.
Dans le roman, Roy Hobbs est un antihéros. On l’aime quand, jeune champion en devenir, il défie et terrasse en trois lancers l’arrogant meilleur joueur de baseball de l’Histoire, pour lui prendre ce titre, au bord d’une voie ferrée au milieu d’inconnus. On l’aime quand, à 34 ans, il retente sa chance et devient le plus grand joueur de tous les temps. Mais ce Roy Hobbs est aussi un être égoïste, rustre, toujours en colère, jaloux, limite harceleur, qui ne considèrent les femmes qu’à travers leurs corps-trophées. Il dégage une forme de violence insidieuse gênante. Parfois, il y a du Monte Cristo en lui, le panache de la revanche. Parfois, c’est un simple revanchard, ne pensant qu’à jouir de son talent en solitaire, maudissant le passé et blâmant les autres.
Bien que le Meilleur soit un roman avec une forte dimension comique, notamment dans la loufoquerie des personnages et des situations, c’est aussi une fiction abîmée comme son héros. Et comme nombre de héros et de romans de Bernard Malamud. Il y a toujours un grincement dans les rouages, un goût d’inachevé ou un destin qui se refuse au happy end. En cela, ce roman est un miroir fêlé mais juste de la société américaine, derrière la belle illusion de l’American Way of Life. C’est aussi l’Histoire du baseball, auquel il emprunte de nombreuses références comme Babe Ruth, Lou Gherig ou encore les Black Sox de 1919. Roy Hobbs est lui-même la rencontre de deux joueurs emblématiques : le célèbre et maudit Joe Jackson (qui inspira également un autre roman culte du baseball, Shoeless Joe de WP Kinsella) et Eddie Waitkus.
Ce dernier, surnommé dans sa jeunesse « The Natural », était un talent qui a éclos dans une équipe semi-pro du Maine avant de reporter son arrivée en MLB pour combattre aux Philippines durant la Seconde Guerre Mondiale. De retour aux États-Unis avec quatre Bronze Stars, le héros de guerre devient, en 1941, un joueur des Chicago Cubs. Polyglotte bien éduqué, il devient une star à Windy City. Double All-Star (1948/1949), Waitkus a une fan, Ruth Ann Steinhagen. Plutôt une harceleuse dont la folie va empirer avec le trade de Waitkus aux Phillies en 1949. Le 14 juin 1949, dans un hôtel de Chicago, elle se fait passer pour un ancien camarade de classe de Waitkus, le fait monter dans sa chambre et lui tire dessus avec un revolver 22mm. La balle rate de peu le cœur. L’apprentie meurtrière appelle la réception pour se dénoncer. Elle est retrouvée berçant le joueur, ayant amoureusement placé la tête du champion sur ses genoux. Elle finit en hôpital psychiatrique et Waitkus, passant plusieurs fois proche de la mort lors de l’opération, survit et revient au jeu quelques mois après, recevant en 1950 le titre de « Associated Press Comeback Player of the Year ».
Eddie Waitkus source d’inspiration du Natural
Le film prend totalement à contre-pied le roman. Le Roy Hobbs de papier est ombre et lumière, cette lumière étant trop vive, finissant par brûler les ailes du héros comme Icare. Le Roy Hobbs du grand écran est solaire. Après tout, c’est Robert Redford qui l’incarne. La part d’ombre, finalement minime, donne ce qu’il faut d’aspérité pour rendre le personnage intéressant et attachant sans l’entacher des tares de son jumeau de papier. Redford impose un Roy Hobbs qui oscille entre le charme naïf du campagnard et la sagesse du joueur aguerri, de l’homme accompli. Alors qu’il est pourtant censé être un individu inachevé. Pour un homme torturé, il est bien trop parfait.
Il est séducteur, plein d’empathie, redresseur de torts. Un héros de cinéma. Un super-héro de comics quand il enfile sa cape de meilleur joueur de baseball. Sa relation aux femmes est donc pleine de délicatesse et de charme malgré les complexités des situations qu’il rencontre. Tout lui réussi ou presque. Même quand le destin décide de le ramener à son parcours chaotique, il se relève et l’emporte. Quand il fait face à la tromperie, à la malhonnêteté, à la malveillance, il est intrépide, malin, talentueux.
Le Meilleur version Hollywood est donc un récit positif de la nation américaine. Le gars de la campagne qui réussit en ville et revient heureux vivre dans ses champs de blés dorés. Le héros qui frappe le homerun de la victoire car, en Amérique, celui qui persévère gagne toujours à la fin. Le père qui transmet sa passion du baseball à son fils, qui lui-même la transmettra au sien. Le self-made man. L’amour vrai qui triomphe. Le bien qui vainc le mal. Etc.
Le grand Robert Redford
Que ce soit des clichés ou le fantasme d’une Amérique qu’on se plaît à rêver, le film en réunit tous les ingrédients. Il en invente même comme le batboy que Hobbs prend sous son aile et à qu’il prendra la batte, fabriqué ensemble, pour le homerun final, remplaçant la sienne baptisée Wonderboy, véritable Excalibur du baseball, qui vient de se briser. Le film insiste beaucoup sur la notion de destinée, y affirmant des références surnaturelles, tandis que le roman la suggère pour souligner que cette notion de destinée est fantasmée par le héros. Dans l’oeuvre de Malamud, les miracles sont des attentes du héros, pas une réalité.
Cette prise de position du film n’est pas si étonnante. Il date des années 80. C’est Reagan, c’est la crise. C’est le capitalisme financier qui prend son envol vers l’ultra-libéralisme. C’est une décennie de désenchantement après Nixon et les crises pétrolières des années 70 qui doit se bâtir de nouvelles illusions. L’Amérique a besoin de nostalgie, de se replonger dans un passé glorieux, celui où les Dieux du Baseball enflammait les foules : Babe Ruth, Lou Gherig, Ted Willians, Willie Mays, Ty Cobbs, Joe DiMaggio. Ce bon vieux temps où l’Amérique avait gagné la guerre, où l’économie était florissante, où JFK n’avait pas encore été assassiné.
En 1952, le contexte est tout autre. Bernard Malamud est un auteur juif. Résonne encore en lui l’horreur de la Shoah et l’antisémitisme qui sévit un peu partout sur la planète, notamment en Europe de l’Est sous le joug stalinien. Beaucoup de ses héros sont d’ailleurs des juifs immigrés d’Europe de l’Est. Le romancier s’intéresse également aux grands drames et petits tracas du quotidien qui parcourent la société américaine d’après guerre, notamment dans l’univers juif new-yorkais. Il met en scène des vies chaotiques. La vraie vie en somme.
De fait, son roman prend le baseball comme métaphore de cette société qui promeut la réussite mais en parsème le chemin de nombreux pièges. Car si la réussite est de faire le tour des bases jusqu’au marbre, ce parcours n’est pas aisé et on échoue plus sur base qu’on ne réussit. C’est tout le propos du roman de Malamud et de son œuvre. Traverser les joies et les peines, espérer la réussite et faire face à l’échec quasi-inéluctable… ou des réussites éphémères.
On peut donc considérer que le film est une perversion de l’œuvre originale. Mais on peut également considérer qu’il s’agit de deux œuvres distinctes, chacune remplissant une fonction propre. L’une cherche à retranscrire la vie telle qu’elle est, l’autre à la sublimer pour en faire un idéal. La vérité face au désir. La contradiction de l’existence. Et le baseball, jeu de paradoxes et de paraboles, s’y prête merveilleusement bien.
Il faut donc lire le roman et voir le film, ressentir deux émotions différentes tout en profitant du plaisir de lire et voir du baseball. Le roman, malgré quelques lourdeurs dans des épisodes oniriques pouvant perdre le lecteur ou la lectrice, est rythmé, tantôt jouissif, tantôt dramatique. Une vraie tragi-comédie qui stimule les neurones. Le film lui est un pur moment de jouissance baseballistique, porté par un personnage presque trop parfait mais admirablement joué par Redford. C’est une montée en puissance vers le homerun de la victoire finale, exaltant l’héroïsme sportif d’un talent naturel.
Deux œuvres, deux plaisirs.
Le Meilleur, de Bernard Malamud (1952)
Traduction Josée Kamoun (avec l’assistance de François Collet de la FFBS)
Editions Rivages